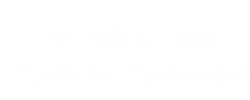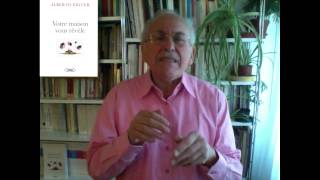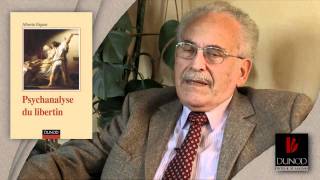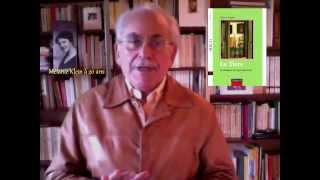Entretien d’Alberto Eiguer par Sophie Collins-Burri
Ce que nous avons hérité de nos « pairs » … Enrique Pichon-Rivière, hier et aujourd’hui
En ce mois anniversaire de la S.T.F.P.I.F, née le 12 juin 1995, il semblait important de solliciter Alberto Eiguer, l’un des fondateurs et ancien président de la S.T.F.P.I.F.
S.C.B. : Merci Alberto, vous manquiez beaucoup, il est important dans cette rubrique de pères en pairs d’avoir le retour d’expérience de chacun, de savoir comment vous en êtes venu là, qu’est qui a fait que vous en êtes venu à la thérapie familiale.
A.E. : La question est pertinente, cela remonte dans le temps, dans un enchevêtrement de situations. Je pense que cela peut remonter à la petite enfance, et mes prédispositions groupales venaient des aménagements singuliers de ma famille. Nous vivions tous dans une maison spacieuse, mais il y avait deux familles qui habitaient la même maison, celle de mon oncle et de ma tante, la sœur de mon père, et notre famille. Cet aspect me prédisposait particulièrement à être à plusieurs, et je considérais, assez jeune, mes deux cousins comme des frères d’une certaine façon. Je faisais la distinction, ils étaient mes cousins, mais il y avait une fraternité, une familialité telle que les choses se coordonnaient de manière remarquable. Ensuite, il y a eu les études de médecine et aussi quelques études de psychologie en simultanée. On avait, la possibilité à l’époque, quand on était étudiant en médecine, de suivre des cours de psychologie, avec des rencontres qui ont été prophétiques car j’ai ainsi connu de grands noms de la psychanalyse argentine.
Les contacts avec le groupe et la famille se sont intensifiés avec deux voies que j’ai suivies, peu de temps après la fin de mes études et quand je suis devenu médecin. La première est mon inscription à l’Ecole de Psychiatrie Sociale – c’est son nom à l’époque – qui était dirigée par Enrique Pichon-Rivière, et où on apprenait le groupe. Je reviendrai là-dessus. Et l’autre, un peu plus tard, quand j’ai commencé à travailler dans un Hôpital de jour d’adolescents. Ce service proposait des thérapies, tout le monde devait faire des thérapies et les familles des patients étaient en thérapie familiale. Après la psychanalyse individuelle, j’ai entamé la psychanalyse des familles et des couples. A l’époque, tel que je me souviens, les systémiciens et les psychanalystes n’étaient pas aussi divisés que plus tard. Les Argentins sont réceptifs à tout ce qui est nouveau. Dès lors qu’on s’occupait des familles, on travaillait beaucoup les textes européens et nordaméricains, qui étaient traduits assez rapidement, ainsi que les articles, les livres des écoles de Palo Alto et de New-York, etc. On était assez au courant, tout comme on travaillait différents auteurs psychanalytiques.
Le programme de cette école d’E. Pichon-Rivière s’étalait sur trois ans. La première année était consacrée à l’étude de la théorie et de la pratique d’E. Pichon-Rivière, une théorie psychanalytique individuelle et groupale spécifique, très marquée par son modèle, avec la pratique en groupe opérationnel (« grupo operativo »), qui me semble avoir son originalité. A cette époque, son modèle était fort développé et j’ai reçu tout cela la première année. Il faisait beaucoup de cours. La deuxième année était consacrée à la psychopathologie. On apprenait, à la fois, tous les tableaux cliniques de la psychiatrie, et leur compréhension analytique et selon la psychiatrie sociale et familiale. Tout cela, c’est une synthèse qu’on reconnait maintenant car la formation de la STFPIF lui ressemble. La troisième année était consacrée à la protique et la technique. On étudiait les thérapies psychanalytiques individuelle, familiale, de couple et institutionnelle. Pour cela, j’ai eu des professeurs qui sont des personnalités importantes de la psychanalyse, comme José Bleger, Fernando Ulloa, Armando Bauleo, Hernan Kesselman, Eduardo Colombo, qui s’est installé peu de temps après en France où il a été connu comme psychanalyste. Il accordait une grande importance à la liberté sur tous les plans.
Pour chaque cours, qui était hebdomadaire, le cycle s’étalant sur plusieurs mois, on commençait par une conférence qui n’était pas solennelle. La présentation théorique était suivie par un groupe opérationnel, dont le but était de reparler de la conférence. Le « schème » d’E. Pichon-Rivière suit une méthodologie spéciale. L’idée générale est que le professionnel en formation entend ce qu’il peut ou veut entendre selon la couleur des cristaux de ses lunettes et selon ses filtres, l’accueillant selon son approche personnelle ou en résistant à l’idée ou à l’auteur. La tendance groupale, ses méandres et mythes entrent ainsi en jeu. La résistance pour E. Pichon-Rivière, c’est une résistance au changement, incontournable, inévitable : résistance à perdre les acquis ou résistance qui se manifeste par le dérèglement que peut causer le nouveau.
Cette méthode opérationnelle souligne comment votre intimité est profondément mobilisée puis empreinte par ce que vous apprenez. En l’élaborant, vous pouvez apprendre, l’adopter ou vous adapter. Cela signifie que toute idée devient votre idée propre. Tout était compris en termes groupaux, c’est-à-dire un bouillonnement du collectif, de comment cela circulait entre nous, comment on échangeait, on s’accordait créant des liens intersubjectifs. Beaucoup de ces concepts m’ont marqué et me marquent encore à ce jour.
Il m’est venue une anecdote. Beaucoup de choses se passent dans ces formations et autour, dans le domaine des échanges informels. C’est-à-dire pendant la pause, dans les rencontres du couloir, après ou avant les cours, dans le bistro après-coup, ce qui finissait souvent tard. Je ne me souviens pas qui avait fait la conférence. J’arrive à la salle où on s’installait pour la pause, et E. Pichon-Rivière était en pleine discussion avec E. Colombo autour du dernier film sorti : c’était Belle de jour de Buñuel, avec Catherine Deneuve. Ils n’étaient pas tout à fait d’accord, ils se disputaient. E. Colombo a défini Buñuel comme « un petit bourgeois pornographe », quelque chose comme cela. E. Pichon-Rivière a objecté cette idée. Pour lui, le film n’est pas non plus une critique de la bourgeoisie, mais il s’agit essentiellement de montrer les enjeux de l’esclavage, et les épreuves qui vit la femme en quête de la libération féminine. Il ne pouvait pas supporter des critiques personnelles. Il dit : « Critiquer le rôle de Catherine Deneuve est facile et gratuit. » Voilà les positions de ces deux personnages ; cela les caractérise d’une certaine manière. C’est un exemple du comportement de E. Pichon-Rivière vis-à-vis d’un film : il prenait en considération l’ensemble des données psychiques, sociales, artistiques, idéologiques pour trouver une synthèse où primait l’intimité la plus inconsciente. Son exégèse se dégageait de toute lourdeur polémique ou sceptique pour devenir libératrice.
S.C.B. E. Pichon-Rivière a été abordé en formation, mais on ne connaît pas toutes ces facettes, méconnues.
A.E. Oui c’est cela, il y a eu beaucoup de choses importantes. Je vais raconter une autre anecdote. On a fait un stage. Il était mené par E. Pichon-Rivière. Il nous a pris à plusieurs, il s’agissait de faire une enquête psychosociale à propos d’une demande reçue par son Institut concernant un produit alimentaire. C’était une poudre chocolatée qui avait perdu une part importante du marché ; elle se vendait de moins en moins. L’entreprise voulait en connaitre les raisons. Nous avons construit le questionnaire et on s’est mis au travail pour faire passer cette enquête au public adulte. L’échantillon a été établi avec des critères définis et sélectionnés soigneusement ; c’était très sérieux. Puis on est partis soumettre le questionnaire à un certain nombre de personnes. La plupart d’entre elles expliquaient la perte de la notoriété de cette poudre chocolatée par les difficultés rencontrées pour son utilisation : c’était une poudre qui avait du mal à se dissoudre dans le lait. Il y avait une autre marque qui était beaucoup plus adaptée. Ce produit en étude était très lié à l’enfance de chacun. Jadis beaucoup de personnes la consommaient. S’ajoutait à cela le fait qu’il y avait une publicité radiophonique qui passait tous les jours et portait sur les aventures de Tarzan, un programme très suivi par les enfants et les adolescents. Les enquêtés disaient qu’ils avaient eu comme un « transfert positif » envers cette poudre qui leur rappelait leur propre enfance. Adultes ils l’ont donné à leurs propres enfants parce qu’elle évoquait ces souvenirs. Leur transfert était chargé de cette réminiscence. Mais au bout d’une période « idyllique », cet enthousiasme a disparu et les résultats pratiques ont pris le dessus. A la suite de l’enquête, nous avons analysé les résultats, en petits groupes, et E. Pichon-Rivière nous a dit : « Je vous remercie pour le travail. Nous avons analysé à notre propre niveau et nous avons décidé de proposer au producteur de cette poudre de changer le flacon d’emballage, l’étiquette que l’on met sur le flacon. Nous lui avons dit qu’il fallait absolument le moderniser pour qu’il attire plus l’attention. »
Certains d’entre nous ont été très critiques, disant « Tous ces efforts pour rien », ajoutant « Vous avez le pouvoir de leur demander d’améliorer ce produit. » Et E. Pichon-Rivière a répondu : « Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense qu’il faut changer la forme. L’enveloppe constitue une approche psychologique extrêmement importante, parce qu’il représente quelque chose liée à notre propre corps. Changer l’enveloppe, la moderniser, c’est aussi imaginer que chacun va se projeter sur le produit de façon différente. » Et là-dessus a suivi une discussion de sa part sur la valeur du rapport entre le contenant, le contenu et le flacon. C’était formidable parce qu’il nous apprenait beaucoup de choses. Il était assez fascinant dans sa réflexion. Le stage c’est bien passé, et s’est bien fini, pour moi en tout cas. Je pense aujourd’hui que E. Pichon-Rivière restait indifférent au mélange lait-chocolat (sein-mamelon ou maternel -paternel) ; l’important était qu’on les réunisse dans un même contenant attrayant.
Vous voyez le type de choses qu’on faisait. D’un bout à l’autre, je vous ai montré des éléments extrêmement différents, mais qui viennent tous signifier l’intérêt pour le groupal et ses rapports les plus intimes avec le psychique.
S.C. B. Toutes vos études vous les avez effectuées en Argentine, mais à un moment donné vous l’avez quittée pour venir en France.
A.E. Oui, quand je suis arrivé en France, une première fois, c’était pour un stage d’un an et demi dans l’Institut Marcel Rivière de La Verrière afin de me former à la psychiatrie institutionnelle. J’ai fait beaucoup de choses : suivi des cours, des thérapies, des thérapies de groupe, des recherches… J’ai commencé à m’intéresser aux recherches sur la maison, justement, dans cette institution. Ensuite, quand je suis revenu en 1973, j’ai travaillé dans plusieurs institutions, d’abord en m’intéressant à divers domaines liés aux groupes, à l’institutionnel, à la psychose. Ce que j’avais commencé à faire en Hôpital de jour m’a incité à travailler sur le groupe, notamment dans la Clinique psychiatrique MGEN de Rueil-Malmaison où l’on faisait des groupes-thérapie de courte durée. Ensuite j’ai travaillé pendant très longtemps en Hôpital de jour où je pratiquais des thérapies individuelles, familiales et de temps à autre de couple.
S.C.B. Il y a tous les apports que vous avez reçus en Argentine, mais est-ce-que je peux vous demander ce qui vous a amené à venir vous installer en France ?
A.E. Oui, je suis venu en France pour continuer ma formation psychanalytique et poursuivre ma pratique. L’idée était la formation, mais c’est vrai aussi que ces années-là on avait envie de partir d’une Argentine en guerre civile larvée. Et grâce à ma venue en France, un grand merci à la France, j’ai été épargné de la répression politique lors la dictature militaire qui aurait pu me couter cher.
S.C.B. J’associe avec tout ce que vous avez écrit Alberto. On parlait de la maison tout à l’heure, là de l’exil, les liens avec votre histoire aussi. Forcément, ça ne vient pas de nulle part.
A.E. Je suis né dans une famille où mes parents étaient des immigrants, des migrants, le mot migrant est plus ouvert. Ma lignée était migrante depuis plusieurs générations : aucune génération n’a habité le même endroit. Mes parents étaient très accueillants recevant les migrants de la famille provenant de leur village ou région. Et quand je suis né ils étaient âgés. Mon père aurait pu être mon grand-père. J’ai eu souvent le sentiment qu’une longue histoire pesait sur mes épaules. Ma mère m’a beaucoup parlé de son village natal dans le sud de la Pologne, de ses proches, de ses voisins, avec leurs petites histoires, leurs anecdotes croustillantes. Avec passion, avec humour, elle était une bonne conteuse. Ces personnes ont peuplé notre espace transitionnel. Longtemps après, j’ai compris qu’elle en faisait le deuil. C’est une des raisons pourquoi le processus d’immigration m’a beaucoup intéressé. Il y a la question des origines bien sûr, des racines, mais plus tard je me suis intéressé à l’interculturel, et avant cela au transgénérationnel. J’ai souvent essayé d’articuler tout cela. Le fait que mes parents étaient tels qu’ils étaient a encouragé mon désir de migrer. Cela a facilité mon insertion et adaptation ; je n’ai pas souffert des difficultés qu’ont connu d’autres migrants.
S.C.B. Une fois que vous vous êtes installé en France, vous avez fait des rencontres, de nouvelles rencontres, concernant les groupes, les familles, les institutions, qui ont amené à fonder par la suite la SFTFP et la STFPIF.
A.E. J’étais proche de Didier Anzieu, de René Kaës et de leur groupe. Ensuite, il y a eu d’autres rencontres qui ont été significatives, et avec lesquelles nous avons fondé les différentes sociétés. On a entamé un long processus et aujourd’hui on fête les 30 ans de la SFTFP et de la STFPIF, qui se consacre à la formation. On peut parler du domaine de la formation. Je n’ai pas développé le groupe opérationnel dans les formations, mais j’ai une sensibilité groupale, c’est une espèce de facteur universel, même en analyse individuelle ; je le pense tout le temps. Je pars de l’idée que lorsqu’on entre en groupe tout est changé, tout est modifié, le groupe emporte, son atmosphère, son affectivité, et aussi les liens qui se tissent entre les différents membres du groupe. Et par-delà on se transforme soi-même. La rencontre avec André Ruffiot a été aussi significative, je me suis lié d’amitié avec Evelyne Granjon assez rapidement, et puis il y a eu les rencontres internationales qui se sont multipliées, jusqu’au moment où j’ai eu l’idée de créer l’AIPCF.
S.C.B. Quelle association a été créée en premier ?
A.E. L’association qui a été créée en premier fut l’A.PSY. G, à laquelle j’ai participé comme tant d’autres. C’est vrai que pendant un long moment j’ai fonctionné comme électron libre, même dans des associations comme l’A.PSY.G. Un collectif est marqué par des dénominateurs communs, mais nous avions des différences. Je suis un pichonien soft, un blégerien soft. Je les connais théoriquement, mais mon modèle personnel est une synthèse avec une prédisposition, qui me paraît encore à réfléchir, à privilégier la pratique. De là les séminaires sur l’interprétation, ma sensibilité à l’inter-fantasmatisation ; les livres que j’ai écrits parlent abondamment du transfert et du contretransfert, etc.
S.C.B. Et le fait de devenir formateur à votre tour, de transmettre à votre tour, si j’ai bien compris c’est venu très vite, voire d’emblée ?
A.E. Les groupes de formation je les ai commencés assez précocement. Et j’en ai parlé avec Jean-Pierre Caillot, Gerard Decherf, Claude Pigott, et les ai mis au courant des groupes de formation que j’avais fait, comme les groupes théorico-cliniques du programme de la STFPIF, et après on retisse les expériences, on arrive à une synthèse, rien n’est définitivement comme à l’origine. J’ai commencé dans les années 1980, et j’ai fait des supervisions de couples, je n’avais pas beaucoup de groupes au départ, puis je me suis mis à les organiser. Quand on a créé la STFPIF, j’avais déjà des groupes de formation, que j’ai intégrés, progressivement, dans la formation de la STFPIF. Il faut dire que j’aime beaucoup enseigner, partager, et c’est une source de savoir et d’amitié ; l’émotionnel y est extrêmement important. Cette ambiance de groupe créée par l’alchimie, la magie du groupe, me plaît beaucoup. Il y a aussi l’expérience universitaire, mais l’université n’enseigne pas la thérapie, malheureusement. Je m’occupais de choses importantes à l’époque quand j’ai enseigné à la faculté, je fais toujours partie du Laboratoire de recherche dans la suite de l’obtention de l’Habilitation à la direction des recherches en 2000. Donc, la clinique, la pratique, la formation, la recherche, tout cela se combine et s’alimente réciproquement.
Il y a dans l’histoire du groupe opérationnel d’E. Pichon-Rivière une évolution, une adaptation. Armando Bauleo, qui a quitté l’Argentine au moment de la dictature, pour le Mexique et ensuite l’Italie, a été quelqu’un qui, à mon avis, a beaucoup fait avancer la théorie opérative d’E. Pichon-Rivière en l’appliquant à la psychanalyse individuelle, et à différents groupes de formations, thérapeutiques et animation. En Italie, en Espagne, on pratique beaucoup des groupes opérationnels, utilisés, par exemple, en entreprise. On réalise une consultation institutionnelle dans une entreprise qui a des problèmes ; c’est la première étape d’un protocole bien configuré ; parfois l’expérience se transforme en un groupe opérationnel de l’encadrement ou de l’équipe, selon les cas. A Madrid, une troupe monte une pièce de théâtre, et elle décide d’aménager un groupe opérationnel pour préparer la représentation. Cela peut concerner différentes activités artistiques et culturelles, dans l’évolution d’une pratique qui est vivante.
Dans la mouvance psychanalytique, des concepts et des pratiques se sont développés progressivement après Freud. Ainsi les recherches sur le groupe ont donné naissance à la notion de champ ; la théorie des relations objectales, à celles du lien et de l’intersubjectivité ; l’archaïsme à l’origine de la famille et de l’humanité, à celle du transgénérationnel ; la théorie des deux différences majeures des générations et des sexes, à celle d’une troisième différence, l’interculturelle (Kaës).
Je vais vous raconter encore une anecdote. E. Pichon-Rivière a avancé l’idée de métaphores sociales pour illustrer et comprendre ce qui se passe au niveau d’un petit groupe, d’une famille. Il appliquait certains évènements sociaux comme changement de constitution, révolte populaire, putsch, coup d’état, machiavélisme, conflit social, grève. A une occasion, il m’a dit : « Alberto, j’ai la demande d’un collègue pour une famille, je te propose de faire une consultation d’urgence à domicile – c’était un dimanche – il faut y aller d’urgence parce que les fils ont fait un coup d’état. Le père, un grand tyran, veut reprendre le pouvoir, et il les a carrément mis à la porte. » J’en ai eu un accès de panique… La métaphore du coup d’état m’a permis de surmonter mes réticences, pensant qu’il y a quelque chose d’intéressant à élaborer théoriquement. L’idée de métaphore est chère à Freud quand, pour conceptualiser, il utilise la métaphore de la machine, de l’appareil, du travail, etc. Freud en reste toutefois analyste, ce sont juste des métaphores. L’idée de calquer les phénomènes sociologiques – la société actuelle donne beaucoup d’éléments de dysfonctionnement – pour entendre le dysfonctionnement d’une institution, d’un groupe de formation, d’une famille, prospère actuellement…, mais il me paraît plus intéressant de lire ces derniers en termes de métaphores. Cela permet une réflexion plus distancée et finalement plus substantielle, tout en conservant la notion d’analyse de groupe. Pour la famille dont je parle, les fils sont allés trop loin dans leurs revendications au point qu’il ne se posait pas d’autre alternative que chasser le père tyran ou être banni (s) du foyer. Les nombreuses revendications aussi justes qu’elles ont pu apparaitre ne permettaient pas au père de modifier son comportement. Il s’est senti totalement dépossédé et humilié ; alors il a encore une fois fonctionné en tyran.
Une chose que j’ai fait aussi pendant ma formation et dont je suis fier, c’est lorsque Enrique Pichon-Rivière m’a orienté un patient psychotique. Lui voyait la famille et il m’a invité à l’accompagner dans les entretiens familiaux, d’être « son co-thérapeute ». Je continuais à voir le jeune. J’avais peur, mais l’expérience a valu la peine, je l’ai vu fonctionner comme thérapeute et ce fut très intéressant. Et nous avions des échanges lors des post-séances, où il parlait très facilement de lui, de son historique, de ce qui lui arrivait, de ce qu’il ressentait. Le contre-transfert était extrêmement important dans sa réflexion.
S.C.B C’est peut-être ça qui est le plus important, qui est plus riche.
A.E. C’est ce qui est plus riche en tant que formation et pour le transmettre aux autres.
S.C.B. Oui, faire des conférences avec vous qui avez connu Pichon-Rivière, comme Haydée Bleger, c’est le partage, on voit les générations successives. A la STFPIF il se partage ça. Nous vous avons rencontré vous, vous avez rencontré Pichon-Rivière, on s’inscrit dans cette suite de générations.
A.E. Je crois que vous pouvez vous considérer de la même famille, appartenant à la même généalogie, avec cet élément très important qui est que Enrique Pichon-Rivière était très libre. Il avait beaucoup d’idées, il les a peu écrites, hélas, sauf au cours de ses dernières années, des textes qui ont été faits à partir de ses conférences, ses cours…
S.C.B. Il était plus dans la transmission orale que dans l’écriture. Nous nous rapprochons de la fin de cet interview, nous n’allons pas pouvoir tout dire même si je pourrais vous écouter des heures Alberto. Merci beaucoup d’avoir accepté de faire cet interview, qui du coup, symboliquement, paraîtra dans le prochain numéro de L’intermédiaire au mois de juin, qui sera le mois anniversaire de la STFPIF. Je trouve cela très bien.
A.E. Il faut savoir que Pichon-Rivière était aussi un homme de culture, qui m’a marqué. Il était critique d’art, pour la peinture, compagnon du groupe surréaliste en Argentine, créé à la fin des années 1930. Il avait beaucoup de connaissances dans le milieu artistique français. Il connaissait énormément de gens, comme Jacques Lacan, Henri Ey, Paul Sivadon, des membres de la S.P.P. et comme il était d’origine française, ses parents étaient français mais il est né à Genève, sa langue maternelle était le français. Il a appris l’espagnol enfant. Beaucoup de ses concepts, ça je l’ai déduit après, viennent du français, comme avoir un déclic, qui est une expression française. Il l’a introduit comme un concept, c’est une extension figurative d’un mot.
Pour la conférence, il s’agira de transmettre quelques concepts, des exemples et de donner un profil de sa personnalité comme de son message. Il a créé un langage à partir de ses concepts, à l’exemple des notions de tâche, d’émergent, etc. Lors d’un de ses cours, j’ai entendu qu’il parlait de défense cynique, et de là est né mon livre sur Le cynisme pervers en 1995 (L’Harmattan). Mon intérêt pour la perversion s’inspire un petit peu de son cours sur la perversion. C’est lui qui a parlé, dans la deuxième année, du sado-masochisme, un cours riche pour les jeunes qu’on était, nous avons découvert des auteurs comme le Marquis de Sade, Sacher-Masoch, etc. Ses cours étaient illustrés par des éléments historiques et littéraires. Lautréamont par exemple, auteur maudit, fort apprécié par les surréalistes, qui a fini ses jours à Montevideo. Cet homme qui était affable, avec beaucoup d’humour, très délicat, s’intéressait à des auteurs maudits. C’est l’un des Argentins les plus francisés de tous ceux que j’ai connus. Comme Willy Baranger, que j’ai connu par la suite, qui était aussi français et avec qui j’ai fait une tranche. On n’a pas parlé de tout cela, je me suis surtout centré sur l’enseignement et la pratique. On ne peut pas parler de tout, on va arrêter là.
S.C.B. J’ai l’impression d’avoir eu les prémices d’une conférence. Merci beaucoup Alberto.
A.E. Merci de votre attention et de votre écoute très accueillante.